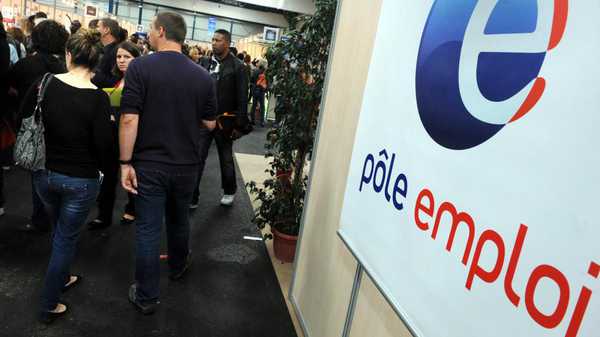
Moins 1,7% en mars, c’est donc la baisse du chômage enregistrée en ce printemps 2016. Il va de soi qu’il faut accueillir la donnée statistique comme une bonne nouvelle et s’en réjouir à la mesure de sa valeur. Car se lancer dans une forme de triomphalisme, dont se sont d’ailleurs gardés le ministre du Travail, Myriam El Khomry et le Premier ministre Manuel Valls, pourrait apparaître comme fort présomptueux et très certainement prématuré au regard de la fragilité de la conjoncture et de la versatilité du taux concerné. Et si d’aventure l’un d’eux (ou un autre) devait se lancer dans une exégèse des politiques actuelles, ce panégyrique, malvenu en l’état, confirmerait une tendance qui prévaut dans notre pays depuis des années, tout comme dans d’autres d’ailleurs, à savoir considérer le taux de chômage comme une arme politique, comme un argument électoral déconnecté de toute réalité sociale. Une explication s’impose. La question de l’emploi est devenue au fil des années le juge de paix de tout élu ou aspirant à des responsabilités électives. Et pour cause, le travail, outre sa vocation sociale et intégratrice fondamentale, est aussi l’unique moyen de subsistance que l’Humanité ait trouvé pour satisfaire les besoins essentiels de chacun. La valeur travail, comme l’a très bien expliqué la sociologue Dominique Méda dans nombre de ses essais, passe avant toute chose, parfois avant même la notion de cellule familiale, c’est dire le poids de celui-ci dans la vie de l’individu.
Communication et action
Or, les difficultés auxquelles est confronté l’individu pour exercer une activité professionnelle rémunérée se heurte aussi à l’incompréhension de la sphère politique, quelque soit son obédience, qui ne ressent pas cette nécessité de la même manière. Rares sont les ministres, voire les Présidents de la République, à avoir arpenté les moquettes usées de feu l’ANPE ou aujourd’hui de Pôle Emploi….On ne peut pas leur en faire le reproche, ce n’est pas leur vocation première et s’y rendre relève souvent plus de la communication que de l’action politique de terrain. Autant s’en abstenir donc car rentrer dans une agence Pôle Emploi ne permettra jamais à l’élu de ressentir ou d’éprouver les sentiments d’un demandeur d’emploi. En revanche, il serait opportun de lui rappeler que taux de chômage et emploi, indissociables corollaires, ne se résument pas à une somme de statistiques maniées avec adresse et habileté à des fins d’ambitions personnelles. D’aucuns y verraient une forme de cynisme, d’autres une forme d’électoralisme facile. Et l’erreur d’avoir été trop souvent commise, déshumanisant la question du chômage en renvoyant sa réalité, c’est à dire un drame social et humain où se mêlent isolement et perte de confiance en soi, loin de la responsabilité effective d’un homme ou d’une femme politique en charge d’imaginer des solutions pérennes et efficaces. Non que ces derniers n’aient pas cherché à résoudre le problème, dire le contraire serait faux, mais la valeur quasi-vitale de l’emploi a conféré à celui-ci un statut de question prioritaire lui permettant de passer avant tout autre problème. A raison d’ailleurs. Donc devenus prioritaires, emploi et chômage deviennent des armes redoutables pour celui qui saura, non pas les manier, mais en connaître les ressorts. Un homme politique, quel qu’il soit, a pertinemment compris que son avenir tenait d’abord à la résolution de ces deux questions.
Encre et temps économique
Engranger des signatures de contrats est naturellement louable. Mais tant que ces signatures ne se traduiront pas par des créations effectives et directes d’emplois, leurs portées pourtant considérables, ne seront ni perçues ni appréhendées et ne se traduiront en rien dans les urnes. Voilà qui explique l’empressement de tout homme politique à préciser, l’encre du contrat à peine sèche, combien d’emplois seront créés via ces signatures. Voilà une manière comme une autre d’user de l’arme citée plus avant. Mais est-elle comprise par celui qui franchit la porte de Pôle emploi ? Le temps économique a sa propre vitesse et ce en dépit des efforts engagés par le personnel politique pour essayer de l’accélérer. C’est d’ailleurs une des limites de l’action politique dans son ensemble, celle ne pourvoir influer qu’à la marge du champ économique en essayant de créer des conditions favorables, bref de dégager le terrain. Mais cette action marginale, aussi généreuse ou efficace qu’elle puisse être, ne peut être instrumentalisée ne serait-ce que par respect et décence à l’endroit de ceux qui recherchent un emploi et qui fondent dans l’action politique de grands espoirs pour enfin sortir de l’ornière.
 Ainsi, un courriel malencontreux et malheureux a trahi les intentions de Nicolas Sarkozy, le message en question laissant très clairement supposer que l’ancien Chef de l’Etat serait candidat aux primaires du parti Les Républicains. Trahison ou stratégie finement calculée ? D’aucuns, connaisseurs ou non, des rouages qui meuvent la politique savent que rien n’est jamais innocent ou accidentel en terme de fuite. Donc, le secret de Polichinelle, gardé jusqu’alors avec des précautions toutes relatives, a été dévoilé à dessein. Il serait naïf d’y voir une maladresse ! « Oups ! J’ai gaffé ! » aurait pu alors se dire l’expéditeur du mail. Que nenni ! Il convient cependant de se demander pourquoi, alors que le scrutin devant désigner le candidat des Républicains à l’élection présidentielle ne se tiendra qu’à l’automne prochain, un tel message a été diffusé ? La raison tient dans le contexte actuel qui fait office d’espace-temps au sein même de l’opposition et dans la personnalité de l’ex-président. Le contexte tout d’abord. A droite, les prétendants s’agitent et s’activent. Alain Juppé, Bruno Lemaire, François Fillon (candidats parmi les plus dangereux pour l’ancien président) n’ont jamais caché leurs ambitions personnelles défendant chacun d’eux des projets plus ou moins viables ou crédibles. Si certains d’entre eux visent clairement l’Elysée (Alain Juppé et François Fillon), le dernier, Bruno Lemaire, bataille aujourd’hui avec l’espoir de s’inviter au festin présidentiel avec en point de mire la table de Matignon. Portés par les sondages pour certains, écrivains à succès pour d’autres, tous, quels qu’ils soient, sont actifs et existent dans l’espace médiatico-politique.
Ainsi, un courriel malencontreux et malheureux a trahi les intentions de Nicolas Sarkozy, le message en question laissant très clairement supposer que l’ancien Chef de l’Etat serait candidat aux primaires du parti Les Républicains. Trahison ou stratégie finement calculée ? D’aucuns, connaisseurs ou non, des rouages qui meuvent la politique savent que rien n’est jamais innocent ou accidentel en terme de fuite. Donc, le secret de Polichinelle, gardé jusqu’alors avec des précautions toutes relatives, a été dévoilé à dessein. Il serait naïf d’y voir une maladresse ! « Oups ! J’ai gaffé ! » aurait pu alors se dire l’expéditeur du mail. Que nenni ! Il convient cependant de se demander pourquoi, alors que le scrutin devant désigner le candidat des Républicains à l’élection présidentielle ne se tiendra qu’à l’automne prochain, un tel message a été diffusé ? La raison tient dans le contexte actuel qui fait office d’espace-temps au sein même de l’opposition et dans la personnalité de l’ex-président. Le contexte tout d’abord. A droite, les prétendants s’agitent et s’activent. Alain Juppé, Bruno Lemaire, François Fillon (candidats parmi les plus dangereux pour l’ancien président) n’ont jamais caché leurs ambitions personnelles défendant chacun d’eux des projets plus ou moins viables ou crédibles. Si certains d’entre eux visent clairement l’Elysée (Alain Juppé et François Fillon), le dernier, Bruno Lemaire, bataille aujourd’hui avec l’espoir de s’inviter au festin présidentiel avec en point de mire la table de Matignon. Portés par les sondages pour certains, écrivains à succès pour d’autres, tous, quels qu’ils soient, sont actifs et existent dans l’espace médiatico-politique. La force de l’Histoire est de révéler l’action des hommes quand ces derniers, aveuglés par l’instant présent, ne peuvent livrer un jugement affranchi de toutes passions, de certaines en tous cas. Alors puisque sonne déjà le bilan, (quand ce n’est pas l’hallali), du quinquennat de François Hollande, pourquoi ne pas jeter un regard critique sur son action. Mais précisons-le d’emblée, non pas une critique loi par loi, erreur par erreur, ou point positif par point positif. Il s’agit en fait de porter un regard global non sur l’action mais sur l’héritage à venir et l’appréciation qui en sera faite. Première question : Et si François Hollande décrié, poussé vers la sortie, y compris par son propre camp, avait eu raison avant l’heure, avait pressenti les réformes nécessaires au nouvel accomplissement du pays ? D’aucuns crieraient au scandale à la simple évocation de cette idée. Pourtant, la France décrite comme un pays impossible à réformer pour cause de conservatismes divers et variés, qui pullulent à droite comme à gauche, a connu depuis l’arrivée de François Hollande une cure sociétale des plus drastiques en dépit des railleries de ses détracteurs, trop contents en coulisse que le Président de la République actuel s’y casse les dent pour in fine en récolter les fruits. Contraindre la France à la social-démocratie n’était pas gagné d’avance et il se pourrait que François Hollande y parvienne, du moins qu’il imprime un pli que nous ne pourrons qu’épouser.
La force de l’Histoire est de révéler l’action des hommes quand ces derniers, aveuglés par l’instant présent, ne peuvent livrer un jugement affranchi de toutes passions, de certaines en tous cas. Alors puisque sonne déjà le bilan, (quand ce n’est pas l’hallali), du quinquennat de François Hollande, pourquoi ne pas jeter un regard critique sur son action. Mais précisons-le d’emblée, non pas une critique loi par loi, erreur par erreur, ou point positif par point positif. Il s’agit en fait de porter un regard global non sur l’action mais sur l’héritage à venir et l’appréciation qui en sera faite. Première question : Et si François Hollande décrié, poussé vers la sortie, y compris par son propre camp, avait eu raison avant l’heure, avait pressenti les réformes nécessaires au nouvel accomplissement du pays ? D’aucuns crieraient au scandale à la simple évocation de cette idée. Pourtant, la France décrite comme un pays impossible à réformer pour cause de conservatismes divers et variés, qui pullulent à droite comme à gauche, a connu depuis l’arrivée de François Hollande une cure sociétale des plus drastiques en dépit des railleries de ses détracteurs, trop contents en coulisse que le Président de la République actuel s’y casse les dent pour in fine en récolter les fruits. Contraindre la France à la social-démocratie n’était pas gagné d’avance et il se pourrait que François Hollande y parvienne, du moins qu’il imprime un pli que nous ne pourrons qu’épouser. Et si l’impopularité de nos Présidents de la République successifs depuis 1958 tenait, en partie, à l’aspect obsolète et dépassé de notre Constitution ? Le débat n’est pas nouveau en dépit de la réforme constitutionnelle de 2008 qui modifia le texte originel. Par là même, il ne s’agit en rien de dédouaner les différents locataires de l’Elysée des erreurs commises ou des égarements qui sont, ou furent, les leurs (même si la charge est suffisamment lourde pour qu’un homme, fût-il bien intentionné, se heurte aux écueils de la réalité) mais de s’interroger sur les origines et l’environnement global qui présida à l’instauration de la Cinquième République et ce fin d’en comprendre les limites toujours plus criantes. Retour en arrière. En 1958, la France traverse la dernière crise coloniale de son histoire et le Général de Gaulle est alors appelé à la rescousse pour éteindre l’incendie algérien. Si sur le plan international, la France est alors regardée avec plus ou moins de scepticisme en raison de son attachement jugé excessif à ces anciens départements d’outre-mer, la situation économique de l’Hexagone tranche en revanche par un dynamisme retrouvé. Le pays, tout comme l’Europe, est en phase de reconstruction, mais se cherche un homme capable de le conduire sur la voie de l’expansion. En parallèle, épuisée par les crises ministérielles à répétition fruits du bourbier parlementaire qu’est la Quatrième République, la France de la fin des années cinquante cherche aussi à stabiliser un environnement qu’elle juge propice au développement et à raison.
Et si l’impopularité de nos Présidents de la République successifs depuis 1958 tenait, en partie, à l’aspect obsolète et dépassé de notre Constitution ? Le débat n’est pas nouveau en dépit de la réforme constitutionnelle de 2008 qui modifia le texte originel. Par là même, il ne s’agit en rien de dédouaner les différents locataires de l’Elysée des erreurs commises ou des égarements qui sont, ou furent, les leurs (même si la charge est suffisamment lourde pour qu’un homme, fût-il bien intentionné, se heurte aux écueils de la réalité) mais de s’interroger sur les origines et l’environnement global qui présida à l’instauration de la Cinquième République et ce fin d’en comprendre les limites toujours plus criantes. Retour en arrière. En 1958, la France traverse la dernière crise coloniale de son histoire et le Général de Gaulle est alors appelé à la rescousse pour éteindre l’incendie algérien. Si sur le plan international, la France est alors regardée avec plus ou moins de scepticisme en raison de son attachement jugé excessif à ces anciens départements d’outre-mer, la situation économique de l’Hexagone tranche en revanche par un dynamisme retrouvé. Le pays, tout comme l’Europe, est en phase de reconstruction, mais se cherche un homme capable de le conduire sur la voie de l’expansion. En parallèle, épuisée par les crises ministérielles à répétition fruits du bourbier parlementaire qu’est la Quatrième République, la France de la fin des années cinquante cherche aussi à stabiliser un environnement qu’elle juge propice au développement et à raison. Pour qui le football n’est pas un centre d’intérêt, la défaite du Paris Saint-Germain le 12 avril dernier face à Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions est un non événement. Pour ceux qui en revanche nourrissent une certaine appétence pour ce sport, la défaite en question est de nature à soulever nombre de commentaires et réflexions. Et passées les considérations tactiques propres au jeu, en voilà un parmi tant d’autres. Ainsi, au regard du budget présenté en début de saison par le club de la capitale, soit peu ou prou 490 millions d’euros, l’élimination à ce stade la compétition peut s’avérer comme dramatique d’un point de vue économique et financier, pour in fine relever de l’accident industriel tant les attentes étaient grandes. Car aujourd’hui, le sport, en règle générale et le football en particulier, est soumis à des impératifs de retour sur investissement qui dictent la conduite que les principaux acteurs, ici les joueurs, doivent tenir. Salariés d’une entreprise à objet sportif, les footballeurs professionnels doivent gagner même si, les faits le prouvent, ils sont d’abord rétribués pour jouer au football. Pour gagner donc, de considérables moyens sont déployés avec pour finalité déclarée : atteindre l’objectif sportif visé, objectif source de nouvelles perspectives économiques, voire politiques dans certains cas.
Pour qui le football n’est pas un centre d’intérêt, la défaite du Paris Saint-Germain le 12 avril dernier face à Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions est un non événement. Pour ceux qui en revanche nourrissent une certaine appétence pour ce sport, la défaite en question est de nature à soulever nombre de commentaires et réflexions. Et passées les considérations tactiques propres au jeu, en voilà un parmi tant d’autres. Ainsi, au regard du budget présenté en début de saison par le club de la capitale, soit peu ou prou 490 millions d’euros, l’élimination à ce stade la compétition peut s’avérer comme dramatique d’un point de vue économique et financier, pour in fine relever de l’accident industriel tant les attentes étaient grandes. Car aujourd’hui, le sport, en règle générale et le football en particulier, est soumis à des impératifs de retour sur investissement qui dictent la conduite que les principaux acteurs, ici les joueurs, doivent tenir. Salariés d’une entreprise à objet sportif, les footballeurs professionnels doivent gagner même si, les faits le prouvent, ils sont d’abord rétribués pour jouer au football. Pour gagner donc, de considérables moyens sont déployés avec pour finalité déclarée : atteindre l’objectif sportif visé, objectif source de nouvelles perspectives économiques, voire politiques dans certains cas.
